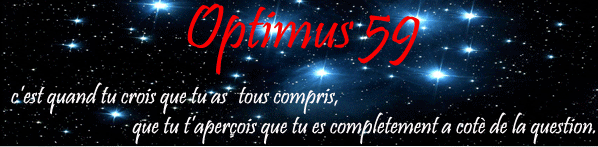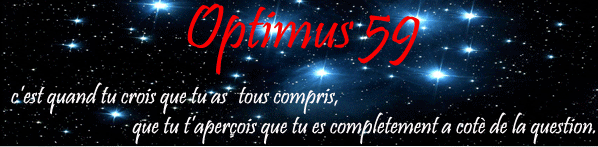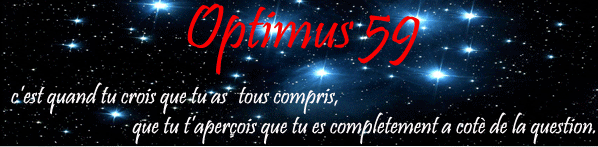bonne lecture



La fabrication massive de doubles tournois intervint sous Louis XIII lorsque ce dernier signa des lettres patentes pour l’ouverture d’ateliers par des entrepreneurs particuliers d’abord à Bordeaux, Nantes et Paris puis à Dijon, St Lô, La Rochelle, Poitiers, Amiens, Toulouse et encore à Aix et Montpellier, le roi vendant son droit aux plus offrants. A partir de 1637, on vit même des contrats passés autorisant à émettre 1,8 millions de livres de cuivre soit 216 millions de pièces, à des « traitants bourgeois » pour des sommes fabuleuses atteignant 465.000 livres à verser au roi !!!
On estime aujourd’hui qu’une quantité de l’ordre de 500 millions de doubles tournois a été émise durant la trentaine d’années du règne de Louis XIII . On comprendra alors, qu’une certaine partie non négligeable de ces pièces ait pu tomber des poches de nos ancêtres et qu’il nous suffira alors peut-être de nous baisser pour en ramasser quelques-unes !
Les transactions qui se traitaient souvent par sacs pleins de menue monnaie et dont des tonneaux entiers circulaient à dos de mulet pour approvisionner les régions du royaume les plus reculées, favorisèrent l’afflux d’imitations et de contrefaçons. Se répandent alors « patars » hollandais, « cuartillos » espagnols et bien entendu « doubles tournois » en tout point similaires à ceux de la royauté (à l’exception des noms et titres des émetteurs, mais qui savait les lire ?) frappés en masse dans les états encore indépendants de l’est de la France (monnaies dites féodales de Béthune, Sedan, Charleville, Dombes, Orange…). Jusqu’au Comtat Venaissin qui sous l’autorité du pape Urbain VIII a son propre atelier qui émet des pseudo-doubles tournois (« quattrinos ») portant au revers 3 abeilles disposées de telle sorte qu’elles simulaient tout à fait les lis de France !
Les nombreuses ordonnances de « décri » (interdiction de circulation ou de paiement avec ces pièces) qui se succédèrent s’avérèrent impuissantes à conjurer ces fléaux auxquels s’adjoignaient les malversations de faussaires qui ne se privaient pas d’émettre des monnaies de cuivre très légères. Il faudra attendre l’arrivée du règne de Louis XIV pour qu’enfin intervienne une sérieuse reprise en mains, sans pour autant stopper la circulation qui perdura au moins jusqu’à l’époque des troubles de la Fronde.
Du fait de ses multiples avatars, le Double tournois dont le cours légal avait été maintenu à grand peine à 2 deniers tournois, subit peu de temps après la mort de Louis XIII, une dévaluation drastique, le ramenant au taux de 1 denier tournois après la fermeture décidée de tous les ateliers encore en activité !
De diamètre variable, compris entre 18 et 21 mm et d’un poids fixé officiellement à 3,138 g., la pièce en cuivre pur à de rares exceptions près, présente un contour circulaire régulier à l’état neuf, souvent agrémenté d’un grènetis et à tranche lisse, mais cet aspect et ces caractéristiques peuvent être altérées par fraude lors de la fabrication, usure ou encore rognage intentionnel.
Dans leur traité de numismatique Monnaies Royales Françaises 1610-1792 paru en 1978, Victor Gadoury et Frédéric Droulers ne distinguaient que 7 types de doubles tournois. Depuis, le Répertoire général des Monnaies de Louis XIII à Louis XVI (1610-1792) datant de 1987, du seul Frédéric Droulers, en avait répertorié quelque 65 ! C’était dire l’extrême complexité de ce monétaire et des difficultés à en fixer une classification cohérente. Aujourd’hui l’ouvrage Doubles et deniers de cuivre royaux et féodaux (1577-1684) de Gérard Crépin paru en 2002 et traitant le problème atelier par atelier, est devenu la bible incontournable.
Sur le droit ou avers est figuré le buste parfois lauré, nu, vêtu, drapé ou cuirassé du souverain plus ou moins réaliste, aux différents àges de sa vie. Ce buste est orienté vers la droite jusqu’à 1640. Les émissions de 1642 et 1643 (type dit de Warin) présentent quant à elles, un buste orienté vers la gauche. Une légende en français ou en latin, ou encore mixte entoure le portrait du roi dont elle peut être séparée par un cercle en léger relief. L’intitulé de la légende qui se réfère dans certains cas à la gràce de Dieu et précise que le souverain est roi de France et de Navarre, est très variable. Nous citerons ici, une liste de ceux dont nous avons connaissance et très probablement non exhaustive.
pour repondre plus precisement à ta question , dans le crépin pour louis XIII aucun atelier SL ( ni C d'ailleurs)
aurais tu une photo ????? pour moi vu que l'atelier officiel n'existe pas , c'est certainement un faux d'époque